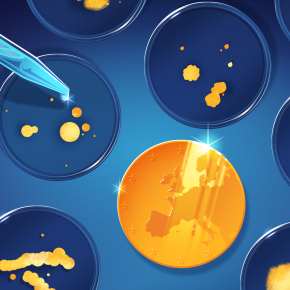Pourquoi le CNRS domine au Conseil européen de la recherche
Avec un total de 1,4 Md€ obtenu depuis le lancement du Conseil européen de la recherche en 2007, le CNRS est et reste son premier bénéficiaire. Mais seul un tiers de ses jeunes recrutés déposent leur dossier de candidature. Une opportunité manquée pour l’organisme, alors que tous pourraient en être lauréats.
L’une a eu son ERC du premier coup, en ayant tenté sa chance « pour ne pas regretter, mais sans trop d’espoir ». L’autre a été lauréate après deux échecs alors qu’elle n’y croyait plus. De leur expérience, elles tirent la même conclusion : les bourses du Conseil européen de la recherche (ERC), la branche recherche exploratoire du programme pour la recherche et l’innovation de l’UE, Horizon Europe1 , demandent un gros travail de préparation mais ne sont pas hors de portée. Et surtout : le jeu en vaut la chandelle.
La première, Clémence Rose, est l’une des 24 « Starting grants » (voir encadré) du CNRS en 2023, avec un projet sur les aérosols marins (Haven) qu’elle s’est décidée à présenter, inspirée par son ancienne directrice de thèse et aujourd’hui collègue du Laboratoire de météorologie physique2 , elle-même lauréate ERC. « J’ai pu constater les moyens et le rayonnement qu’offrent la bourse, au niveau individuel et au niveau du laboratoire », se remémore la jeune chercheuse. C’est d’ailleurs avec l’appui de sa collègue, « pour formuler le volet scientifique du projet » qu’elle a décidé de tenter sa chance. La délégation régionale du CNRS l’a aidée à en évaluer le budget et l’Institut national des sciences de l'univers ainsi que le Point de contact national à préparer l’oral : « pour lequel il faut être à la fois pointu pour les experts et accrocher ceux qui sont plus éloignés de la discipline ».
La seconde, Maud Gratuze, une des 25 starting grants 2024 du CNRS, est lauréate avec un projet sur le rôle du gène ApoE4, un facteur de risque de la maladie d’Alzheimer au sein de l’Institut de neurophysiopathologie3 . Elle était encore en postdoc aux Etats-Unis d’où elle préparait son retour en France quand elle a déposé son projet pour la première fois. « Trop ambitieux », son projet a été retoqué. Malheureusement, la chercheuse n’a pas bénéficié du commentaire des évaluateurs à temps pour sa deuxième soumission. Ce n’est donc qu’à la troisième tentative qu’elle a pu en tenir compte et réduire de moitié son projet. « Après deux échecs, je n’y croyais plus du tout mais c’était ma dernière chance et il y avait pas mal d’attente de mon environnement professionnel », se rappelle-t-elle – un pari gagnant. Elle aussi a été accompagnée par les services du CNRS – ainsi que ceux d’Aix-Marseille université.
Au total, depuis le lancement d’Horizon Europe début 20214 , le CNRS totalise 279 lauréats ERC, ce qui en fait la première institution pour le nombre de projets sélectionnés. Un succès qui dure, puisque, entre 2007, année de lancement de ces bourses d’excellence en recherche exploratoire, et 2023, le CNRS arrive en tête des institutions en Europe pour la part de financement reçu, avec un total de 1,4 Md€. Pour autant, le CNRS souhaite augmenter le nombre de candidatures de ses chercheurs à l’ERC. « Aujourd’hui, seul un tiers des jeunes recrutés déposent un dossier à l’ERC, alors qu’ils ont tous vocation à le faire dans les trois ou quatre ans. Par leur recrutement au CNRS, ils viennent de démontrer qu’ils ont le niveau », explique ainsi le directeur au bureau de représentation du CNRS à Bruxelles Jean-Stéphane Dhersin. En effet, « le concours de recrutement au CNRS est de très haut niveau et le dossier comprend un projet de recherche qui peut tout à fait être transposé pour répondre à l’ERC. Le cahier des charges est un peu le même et le format blanc de la candidature à l’ERC, dont l’objectif est de recueillir des propositions disruptives, permet à toutes les chercheuses et tous les chercheurs de répondre. » Le Contrats d'Objectifs, de Moyens et de Performance du CNRS affiche ainsi pour objectif d’augmenter de 20% le nombre de dépôts de projets ERC entre 2024 et 2028.
Revenons à nos heureuses lauréates pour comprendre ce que leur a déjà apporté leur nouveau statut, pourtant encore récent – à commencer par des moyens nouveaux et conséquents. Un mois après son oral, quand Clémence Rose apprend que son projet a été sélectionné, c’est pour elle « une bonne surprise » mais aussi « le branle-bas de combat ». En effet, la chercheuse a obtenu une rallonge de 500 000 euros au-delà de ses 1,5 M€ de subvention pour lui permettre d’acheter un spectromètre de masse et elle doit anticiper les délais de livraison pour lui permettre de faire coïncider le calendrier des cinq ans d’amortissement de l’appareil aux cinq ans de sa subvention. Elle prévoit aussi le recrutement d’un personnel technique et deux postdocs. Et doit composer avec une autre surprise : un congé maternité, commencé quelques jours avant le lancement du projet, d’autant plus long qu’elle attend des jumelles : en accord avec son référent à l’ERC, la chercheuse a décidé de laisser courir son projet, quitte à demander, à terme, une extension de six mois ou un an. « Les échanges se sont passés de manière fluide, l’Europe est suffisamment consciente des perturbations que peut engendrer la maternité », se félicite-t-elle – au CNRS, entre 2021 et 2023, les femmes ne représentent que 31,9% des candidatures et 29,1% des dossiers sélectionnés. A cette heure, Clémence Rose assure que son projet ne lui a apporté « que du positif » et bénéficie déjà de nouvelles opportunités qu’il s’agisse de nouvelles collaborations ou d’un positionnement pour une campagne de mesures.
Du pavillon en banlieue au château de Versailles
De son côté, Maud Gratuze estime qu’avec son ERC, son projet de recherche est passé d’une dimension « de pavillon en banlieue à château à Versailles » : sa subvention va lui permettre de recruter deux postdocs et de financer des expériences. « Cinq ans de tranquillité budgétaire vont me permettre de faire les choses mieux et d’aller plus loin dans mes expériences », se félicite la chercheuse qui constate déjà la visibilité nouvelle que lui offre sa subvention, ainsi qu’à son institut « encore jeune ». « On me contacte pour le représenter ou représenter le CNRS et quand je veux collaborer avec quelqu’un, cela va beaucoup plus vite », résume-t-elle.
Avec les années, la réputation de l’ERC s’est étendue bien au-delà des frontières de l’Europe. « L’ERC permet aux chercheurs, en Europe ou au-delà, à partir du moment où ils acceptent de venir travailler en Europe, de développer leur créativité, de partir de leurs idées et créer un programme de recherche permettant de lever des verrous à la hauteur de leurs ambitions scientifiques », développe Sylvie Lorente, membre du conseil scientifique de l’ERC. Le conseil scientifique, soit l’organe garant de l’indépendance du programme, a d’ailleurs revu courant 2024 les critères d’évaluation des dossiers « de façon à mettre l’accent sur le projet, et moins qu’auparavant sur la réputation du chercheur qui le porte ». « Ce qui intéresse l’ERC avant tout, c’est l’excellence d’une idée permettant d’avancer les frontières de la recherche, et la capacité du chercheur à la mettre en œuvre », résume Sylvie Lorente.
Le conseil scientifique a aussi pour mission de « promouvoir l’ERC auprès des instances politiques et du grand public » poursuit Sylvie Lorente qui rappelle que le conseil scientifique s’est prononcé pour un doublement du budget du programme pour la prochaine période budgétaire, 2028-2034. « L’ERC reçoit énormément de projets d’excellente qualité qu’il n’est pas en mesure de financer faute de fonds : si l’Europe n’est pas capable de soutenir l’excellence, elle va aller se développer ailleurs, il en va de l’attractivité du continent, pris en sandwich entre les Etats-Unis et la Chine », explique-t-elle. « Par ailleurs, le montant attribué aux projets n’a pas évolué depuis la création du programme et, avec l’inflation, ce qui était extraordinaire il y a 18 ans a perdu beaucoup de son attrait. »
Le CNRS défend, en son nom et avec ses partenaires européens du G6, ce doublement du budget de l’ERC, rappelle Jean-Stéphane Dhersin. Le directeur du bureau de Bruxelles souligne que le rôle de l’ERC dans l’attractivité de la recherche européenne est mis en exergue dans une série de rapports sur les politiques européennes de la recherche publiés en 2024 : celui d’Enrico Letta, celui de la mission d’experts dirigée par l’ancien ministre portugais Manuel Heitor, celui de cinq économistes, dont le Nobel Jean Tirole ou encore le désormais fameux rapport de Mario Draghi sur la compétitivité de l’Europe. « Le CNRS est une voix importante pour soutenir le budget de l’ERC », souligne Sylvie Lorente qui rappelle que l’agence « tient sa légitimité de la reconnaissance de la communauté scientifique, dont le CNRS est un élément phare. »
ERC : la carte maîtresse du CNRS en Europe
L’an dernier, la Commission européenne a attribué 12,3 milliards d’euros de subventions au travers du programme pour la recherche et l’innovation, Horizon Europe1 . Cela à plus de 12 000 organisations. Le CNRS a obtenu 231 millions d’euros, soit 1,88 % du budget total alloué en 2024. Et si l’organisme marque sa différence c’est notamment grâce au Conseil européen de la recherche (ERC), la branche recherche fondamentale d’Horizon Europe, pour lequel il a obtenu 391 M€ d’euros depuis le lancement du programme en 2021.
Créé en 2007 par l'Union européenne, l’ERC est le principal programme de financement de la recherche exploratoire en Europe. Il soutient des projets à haut risque et fort potentiel menés par des chercheurs de toutes disciplines. L'ERC propose cinq types de bourses :
- Starting Grant : Pour les chercheurs en début de carrière (2 à 7 ans après leur doctorat) souhaitant constituer leur propre équipe de recherche.
Financement : jusqu’à 1,5 million d’euros sur 5 ans. - Consolidator Grant : Pour les chercheurs ayant 7 à 12 ans d’expérience après leur doctorat, afin de renforcer leur équipe et élargir l’impact de leurs travaux.
Financement : jusqu’à 2 millions d’euros sur 5 ans. - Advanced Grant : Pour les chercheurs expérimentés ayant un solide historique de réalisations scientifiques.
Financement : jusqu’à 2,5 millions d’euros sur 5 ans. - Synergy Grant : Pour des groupes de 2 à 4 chercheurs principaux collaborant sur des défis scientifiques complexes.
Financement : jusqu’à 10 millions d’euros sur 6 ans. - Proof of Concept : Une bourse complémentaire réservée aux bénéficiaires ERC, permettant de transformer les résultats de recherche en innovations concrètes (brevets, start-ups, partenariats industriels).
Financement : jusqu’à 150 000 euros sur 18 mois.
- 1Le budget global d’Horizon Europe est de 95,5 milliards d’euros.
Anne Hérival